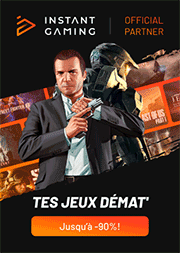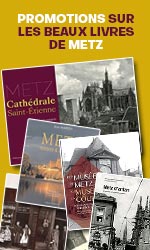L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments dans la discussion.
Gare de Metz-Ville

La gare de Metz-Ville (nom commercial de la SNCF, usuellement appelée gare de Metz) est la gare principale de la ville de Metz. Historiquement cinquième gare principale de la ville, elle est construite par les architectes Jürgen Kröger, Jurgensen et Nachmann dès 1905 et inaugurée en 1908 par les Allemands. Elle est localisée au 3, place du Général de Gaulle.
Histoire
L'ancienne gare de Metz se trouve par-delà les remparts, après la porte Serpenoise, dans un glacis militaire situé au sud de la ville. L'administration allemande décide au début du XXe siècle de doter à la ville, sa porte d'entrée de l'empire à l'ouest, une gare majestueuse. Elle s'inscrit dans tout un programme architectural, la Neustadt, et son quartier gare organisé autour du Kaiser Wilhelm Ring. La tour de l'horloge se trouve en plein centre d'une place en demi-lune où se rejoignent quatre rues.
Un concours d'architecte est lancé par l'Empereur le 10 décembre 1901 [1]. Le chantier débute en 1905 et l'édifice ouvre le 17 août 1908 [2]. Conçu dans un style néo-roman rhénan en grès gris d'Allemagne, le bâtiment est mal accueilli par les Messins, surtout la communauté encore très attachée à la France. Son esthétique fait penser à une cathédrale plus qu'une gare. La gare coûte un total de 29 millions de marks-or, sur les 2 millions prévus à l'origine. En raison des sols et de son emplacement sur un ancien port fluvial, la gare est construire sur 3 000 pieux en béton armé.
Selon la volonté de l'empereur, la gare est en hauteur. Elle est établie à 173m d'altitude et ses quais sont surélevés. Elle dispose de 9 quais et de 10 voies de circulation (Voie 1 et Voie A sur le quai 1). Longs de plus de 300m pour la plupart d'entre eux, les quais devaient permettre de décharger et embarquer rapidement 25 000 soldats et la logistique militaire de l'empire. Le projet est inscrit dans le plan de défense du général prussien Alfred von Schlieffen en 1905 [3]. Un château d'eau de 40m de haut est aménagé à quelques centaines de mètres, d'une contenance de 300 m3 pour alimenter les locomotives.
Au rez-de-chaussée, à droite, une salle d'attente de première classe montre tout le luxe allemand de l'époque de sa création. Elle devient ensuite un restaurant, le « Buffet de la Gare » (tenu par M. Wirtz au début du XXe siècle [4]). Au-dessus de la grande horloge se trouve une fresque de Gothemann représentant une vue de Metz avec le soleil couchant. Après plusieurs années de réfection, l'espace est occupé en grande partie par des locaux commerciaux au début du XXIe siècle dont une « Fnac » depuis 2015 [5]. On y trouve aussi une brasserie (« Hippopotamus » en 2006 puis le « Grand Comptoir » [6]) qui donne sur le parvis. C'est le restaurant de Michel Roth « Terroirs de Lorraine » en 2018 ou 2024. A gauche, un espace ouvert a été occupé par des cellules commerciales au début du XXIe siècle puis fin 2023 une grande verrière est installée après 6 ans de travaux pour y héberger de nouvelles cellules [7].

Le tunnel reliant les deux halles de la gare comportent de nombreuses cellules commerciales et des services. Au nord on trouve le hall des départs et au sud le hall des arrivées.
Fin 2012, un nouveau passage souterrain qui permet de relier le hall des départs à l'arrière de la gare a été inauguré. Les deux tunnels qui permettent de relier l'arrière de la gare côté quartier de l'Amphithéâtre sont alors dénommés [8] : souterrain Jürgen Kröger au nord (départs) qui débouche sur le parvis de l'Amphithéâtre et souterrain Adrienne Thomas au sud (arrivées), qui débouche sur le parvis du même nom [9]. Le second ferme pendant 9 mois entre 2017 et 2018 pour permettre la destruction de la passerelle piétonne et la création de l'accès vers le parvis des Droits de l'Homme [10],[11].
En duplex entre l'étage et le rez-de-chaussée dans la partie la plus au sud du bâtiment principal, des appartements privés, le « salon Charlemagne » ou « salon de l'Empereur » sont fermés au public de 2019 à 2024 [12]. En 2025 l'espace est rouvert à destination des sociétés qui veulent privatiser l'espace.
En juillet 2014 une statue de Jean Moulin sur un piédestal est posé dans le hall d'entrée. Le résistant est mort en gare de Metz en 1943.
La gare de Metz a été élue « plus belle gare de France » en 2017, 2018 et 2020 par un concours organisé par SNCF sur Facebook. En 2024, elle remporte le concours « plus belles histoires de gares ».
Architecture
La gare est la plus longue de France : 300 m de long, pour 16 000 m² de superficie, avec une tour carré surmontée d'une horloge de 40 m de haut. L'édifice, de style néo-roman rhénan, est l'œuvre de l'architecte berlinois Jürgen Kröger (qui a aussi réalisé la gare de Metz-Chambières). La gare est donc composée d'arcs en plein cintre, de portails ornés de chapiteaux racontant les grandes dates de la politique de Guillaume II et de sculptures religieuses [3]. Le portail du hall des départs symbolise une église, avec sa tour de l'horloge, et le portail du hall des arrivés un palais médiéval.
Au-dessus de la fenêtre du palais impérial, au sud, un aigle impérial est entouré d'un chevalier avec un écu dans le dos, et d'une femme tissant la laine. En 1918 il a été remplacé par le blason de Metz. Sur l'autre face, où se trouve le grand vitrail du salon impérial, on peut y voir Charlemagne. Le grand escalier qui mène au salon depuis le rez-de-chaussée est d'inspiration romane et byzantine, avec la représentation des empires orientaux.
A l'angle de la tour de la gare, on trouve un Roland : une statue encastrée dans la pierre [13]. Au départ, cela devait être Saint Georges terrassant un dragon à ses pieds, un projet qui a été annulé pour éviter la vindicte populaire [14]. Un autre dessin le montre sans le dragon, un deuxième projet dessiné sur les plans. Dès 1908, c'est donc une représentation du maréchal Von Haesler portant une épée et un écu aux armes de l'Empire qui est installée. Tourné vers la France, il protège l'Allemagne. En 1918, les Messins accrochent une pancarte « Eh bien celui-ci que fait-il encore là ? » symbolisant qu'aucun Allemand ne devait rester en ville. La statue est transformée en 1919 pour représenter un soldat gaulois qui regarde vers le sud avec un bouclier à la Croix de Lorraine puis aux armes de la ville de Metz [2]. Entre 1940 et 1944, sous l'occupation allemande, la statue est d'abord recouverte d'une bâche puis le maréchal allemand revient à cette place, avec un écu noir et blanc de Metz en 1942. Il reprendra enfin son visage gaulois à la Libération, en 1945.
Références
- ↑ (fr) SALINAS Aurélia, « Présent et passé sur le quai » sur lasemaine.fr (consulté le 22 mars 2025)
- ↑ 2,0 et 2,1 (fr) BASTIEN René, BECKER Albin, Metz mémoire, Saint-Étienne : Edi Loire, 1996 (ISBN 2-84084-041-3)
- ↑ 3,0 et 3,1 (fr) MARTIN Jean, Metz histoire & architecture, Metz : Editions Serpenoise, 1995 (ISBN 2876922231)
- ↑ (fr) BERRAR Jean-Claude, Memoire En Images : Metz Tome I, Saint-Cyr-sur-Loire : Editions Alan Sutton, 1996 (ISBN 2-84253-028-4)
- ↑ (fr) BROUT Cédric, « Pourquoi la Fnac s’est-elle installée à la gare de Metz ? » sur Républicain Lorrain (consulté le 22 mars 2025)
- ↑ (fr) PLOOOM, « METZ : Le buffet de la Gare ! » sur Plooom's (consulté le 25 mars 2025)
- ↑ (fr) VAUCHER Jonathan, « Metz : un défi architectural pour accueillir deux commerces en gare » sur Moselle TV (consulté le 5 mars 2024)
- ↑ (fr) SONIA, « Nouveau passage souterrain de la Gare de Metz : accessible dès la Nuit Blanche 5 » sur tout-metz.com (consulté le 25 mars 2025)
- ↑ (fr) SIARI Karim, « Le parvis et la passerelle situés à l'arrière de la gare de Metz inaugurés » sur Republicain Lorrain (consulté le 24 mars 2025)
- ↑ (fr) TOUSSAINT Olivier, « Gare de Metz : le tunnel des arrivées ferme ce mardi » sur Républicain Lorrain (consulté le 24 mars 2025)
- ↑ (fr) S. MJ, « Metz : le tunnel de la gare et la passerelle fermés jusqu’en mai 2018 » sur tout-metz.com (consulté le 22 mars 2025)
- ↑ (fr) VAUCHER Jonathan, « Gare de Metz : le salon de l’Empereur va rouvrir en fin d’année » sur Moselle TV (consulté le 5 mars 2024)
- ↑ (fr) SCHONTZ André, La gare de Metz, Metz : Editions Serpenoise, 2008 (ISBN 978-2876927483)
- ↑ (fr) GAYARD Emmanuel, « La gare de Metz (ep. 2) : qui est donc ce chevalier ? » sur Radio Mélodie (consulté le 25 mars 2025)

 WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz
WikiMetz : Encyclopédie sur l'Histoire de Metz