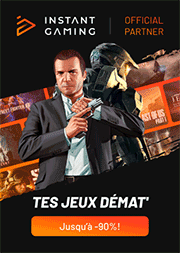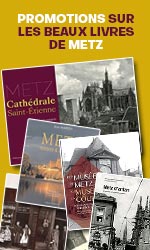L'article n'a pas encore été jugé complet dans ses sources et ses informations. N'hésitez pas à y apporter vos éléments ou à discuter de la page.
« 1877 » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{ébauche}} {{Infobox Chronologie|Année=1877}} ''Cette page concerne l'année '''1877''' du calendrier grégorien.'' __NOTOC__ == Événements à Metz == * Le 5 mai 18... ») |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Événements à Metz == | == Événements à Metz == | ||
[[Fichier:Incendie cathédrale 1877.jpg|vignette|Incendie de la [[Cathédrale de Metz|Cathédrale]] en 1877.|gauche]]La ville de [[Metz]] a été annexée par l'Empire allemand, la plus grande puissance d'Europe, en [[1870]]. [[Metz]] devient le chef-lieu du district [[Bezirk Lothringen]], plus ou moins la Moselle actuelle. Metz est devenue une ville de garnison allemande, transformant son urbanisme et son économie. Comme dans le reste du territoire annexé, les institutions deviennent allemandes, et les noms sont germanisés mais la population reste profondément attachée à la France. De nombreux Messins ont quitté la zone pour rester français, mais beaucoup résistent sur place à la germanisation culturelle. Les « optants » (ceux refusant la nationalité allemande) sont forcés de partir en France. [[Paul Théodore Auguste Bezanson]], premier [[Maire de Metz|maire]] élu sous l'annexion, est remplacé par [[Julius von Freyberg-Eisenberg]]. | |||
Le 5 mai, l'empereur allemand Guillaume Ier se rend à Metz en visite officielle. Le lendemain, le toit de la [[cathédrale de Metz]] prendra feu et [[Incendie de la Cathédrale de Metz|sera ravagé]]. | |||
== Contexte historique == | == Contexte historique == | ||
Après la défaite de la guerre franco-prussienne en [[1871]], la France cherche à se stabiliser sous une 3e République tiraillée entre républicains et monarchistes. Le président de la République, le maréchal Patrice de Mac Mahon (orléaniste conservateur) veut servir de transition avant un retour de la monarchie en France. Mais une crise politique le 16 mai entre le président et la majorité républicaine de l'Assemblée nationale bouleverse la politique française, suite au renvoi du président du Conseil, Jules Simon (gauche républicaine). Le président dissout la Chambre le 25 juin espérant la victoire des monarchistes. En octobre, les Républicains l'emportent et Mac Mahon s'avoue vaincu. La République s’impose progressivement, pour la première fois de son histoire, comme régime stable en France. Après Jules Simon, c'est l'Orléaniste Albert de Broglie qui prend la tête du Conseil, puis le légitimiste Gaëtan de Rochebouët et enfin, après la soumission du président aux résultats, Jules Dufaure (républicain de centre gauche). | |||
En Europe, les relations sont tenues entre la France et l'empire allemand. Le pays cherche à renforcer son armée et un esprit revanchard germe pour reprendre les terres d'Alsace et de Moselle. Dans la région, l'administration allemande a imposé l'allemand comme langue officielle. Les écoles, les institutions et la justice sont germanisées. En plus des « optants » qui ont quitté la Lorraine pour rester français, et ceux qui assurent une sorte de résistance culturelle sur le terrain, en [[1874]] aux élections législatives allemandes, les Alsaciens-Lorrains continuaient d'envoyer des [[Député de Metz|députés]] favorables à la France au Reichstag (les « Protestataires »). | |||
Lors des élections législatives allemandes du 10 janvier, les protestataires remportent une nouvelle fois la majorité des sièges en Alsace-Lorraine. Parmi eux, le maire de Metz [[Paul Bezanson]], l'historien [[Charles Abel]] ou l'industriel [[Édouard Jaunez]]. Les protestataires sont tolérés mais surveillés par les autorités allemandes. Leur présence au Reichstag devient une tribune pour exprimer le mécontentement des populations annexées. | |||
==Pages qui parlent de cette date== | |||
{{Spécial:WhatLinksHere/1877}} | |||
== Références == | == Références == | ||
<references /> | <references /> | ||
Version actuelle datée du 8 mars 2025 à 23:58
Cette page concerne l'année 1877 du calendrier grégorien.
Événements à Metz

La ville de Metz a été annexée par l'Empire allemand, la plus grande puissance d'Europe, en 1870. Metz devient le chef-lieu du district Bezirk Lothringen, plus ou moins la Moselle actuelle. Metz est devenue une ville de garnison allemande, transformant son urbanisme et son économie. Comme dans le reste du territoire annexé, les institutions deviennent allemandes, et les noms sont germanisés mais la population reste profondément attachée à la France. De nombreux Messins ont quitté la zone pour rester français, mais beaucoup résistent sur place à la germanisation culturelle. Les « optants » (ceux refusant la nationalité allemande) sont forcés de partir en France. Paul Théodore Auguste Bezanson, premier maire élu sous l'annexion, est remplacé par Julius von Freyberg-Eisenberg.
Le 5 mai, l'empereur allemand Guillaume Ier se rend à Metz en visite officielle. Le lendemain, le toit de la cathédrale de Metz prendra feu et sera ravagé.
Contexte historique
Après la défaite de la guerre franco-prussienne en 1871, la France cherche à se stabiliser sous une 3e République tiraillée entre républicains et monarchistes. Le président de la République, le maréchal Patrice de Mac Mahon (orléaniste conservateur) veut servir de transition avant un retour de la monarchie en France. Mais une crise politique le 16 mai entre le président et la majorité républicaine de l'Assemblée nationale bouleverse la politique française, suite au renvoi du président du Conseil, Jules Simon (gauche républicaine). Le président dissout la Chambre le 25 juin espérant la victoire des monarchistes. En octobre, les Républicains l'emportent et Mac Mahon s'avoue vaincu. La République s’impose progressivement, pour la première fois de son histoire, comme régime stable en France. Après Jules Simon, c'est l'Orléaniste Albert de Broglie qui prend la tête du Conseil, puis le légitimiste Gaëtan de Rochebouët et enfin, après la soumission du président aux résultats, Jules Dufaure (républicain de centre gauche).
En Europe, les relations sont tenues entre la France et l'empire allemand. Le pays cherche à renforcer son armée et un esprit revanchard germe pour reprendre les terres d'Alsace et de Moselle. Dans la région, l'administration allemande a imposé l'allemand comme langue officielle. Les écoles, les institutions et la justice sont germanisées. En plus des « optants » qui ont quitté la Lorraine pour rester français, et ceux qui assurent une sorte de résistance culturelle sur le terrain, en 1874 aux élections législatives allemandes, les Alsaciens-Lorrains continuaient d'envoyer des députés favorables à la France au Reichstag (les « Protestataires »).
Lors des élections législatives allemandes du 10 janvier, les protestataires remportent une nouvelle fois la majorité des sièges en Alsace-Lorraine. Parmi eux, le maire de Metz Paul Bezanson, l'historien Charles Abel ou l'industriel Édouard Jaunez. Les protestataires sont tolérés mais surveillés par les autorités allemandes. Leur présence au Reichstag devient une tribune pour exprimer le mécontentement des populations annexées.
Pages qui parlent de cette date
- Cathédrale Saint Étienne de Metz (← liens)
- Paul Dupont des Loges (← liens)
- 1881 (← liens)
- Rue des Jardins (← liens)
- Député de Metz (← liens)
- Fichier:Incendie cathédrale 1877.jpg (← liens)
- Fichier:Cathedrale metz detail pignon bras sud transept.jpg (← liens)